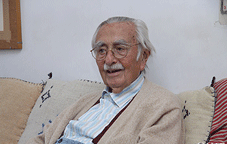
Le doyen de la littérature marocaine de langue française, Edmond Amran El Maleh, (né le 30 mars 1917 à Safi, est décédé le 15 novembre 2010 à Rabat à l’âge de 93 ans et a été enterré à Essaouira. Originaire d’une famille juive d’Essaouira et connu pour ses prises de position en faveur de la « cause palestinienne », El Maleh fut tour à tour professeur de philosophie et journaliste à Paris. À partir de 1980, à 63 ans, il se met à écrire une série de romans et un recueil de nouvelles. Ses écrits sont tous imprégnés d’une mémoire juive et arabe qui célèbre la symbiose culturelle d’un Maroc arabe, berbère et juif. « Écrivant en français, je savais que je n’écrivais pas en français. Il y avait cette singulière greffe d’une langue sur l’autre, ma langue maternelle l’arabe, ce feu intérieur» a-t-il déclaré au Magazine littéraire, mars 1999. Parmi ses œuvres, on retrouve "Jean Genet, Le Captif amoureux et autres essais" (1988), "Une femme, une mère" (2004) et son dernier ouvrage "Lettres à moi même". Dans ses écrits, Edmond Amran El Maleh se démarque essentiellement par sa rénovation thématique et formelle du dire romanesque au Maroc. Il fait partie de ces auteurs dont l’œuvre demeure injustement méconnue en France même si, dans son pays d’origine, elle est célébrée. La venue tardive d’El Maleh à l‘écriture, tout au moins à celle de la fiction, car on lui connaît par ailleurs une collaboration régulière au Monde outre de nombreux essais où la critique d’art tient une bonne place, explique peut-être cette méconnaissance. Au demeurant, l’écriture d’Edmond Amran El Maleh n’est pas d’un abord aisé et son appréhension exige une pratique assidue pour en approcher le mystère ; sa prose poétique réclame peut-être une lecture à voix haute afin d’éprouver son rythme et de s’imprégner du souffle qui l’anime. Cependant, tout est loin d’être dans l’incantation, car l’humour maléhien sert de contrepoint à toute gravité inconvenante et déploie l’art de la fugue pour échapper à l’enfermement générique. L’auteur pratique le récit protéiforme, procédant à la fois de l’autobiographie, de l’autofiction, de la fiction allégorique, du poème. Le commentaire interne ou externe de sa propre œuvre crée une scène de réception qui ouvre des perspectives de lectures multiples au lieu de les cloisonner.
Marocain juif, El Maleh revendique hautement sa culture arabe et berbère. Le « juif oxymoron », comme il aime à se qualifier lui-même (cf. ses Entretiens avec Marie Redonnet, Publications de la Fondation Edmond Amran El Maleh, Grenoble, La Pensée sauvage, 2005), est plus qu’une simple voix minoritaire : c’est une singularité qui n’en finit pas de déconstruire les apories identitaires, les carcans taxinomiques, en leur opposant une écriture libérée des modes et fuyant les protocoles de réception convenus.
Par : R. C.